Langue globale, pensée unique !
Claude Hagège est un linguiste éminent. Quand il passe dans les médias, il y fait des interventions érudites, instructives et édifiantes, en dénonçant, notamment, l'emprise toujours croissante de l'anglais en France, en Europe et dans le monde. Il met souvent en parallèle le fait que cette langue devient la langue de la globalisation par excellence, c'est-à-dire, une langue qui s'est transformée en arme de banalisation massive.
L’anglais, ce parler de l’économie néolibérale, tend à polluer, écraser, pervertir l’expression du français et, plus avant, l'expression diverse et variée de toute l'humanité.
Ce qu’enseigne Hagège

On apprend (pour ceux qui l’ignoraient tout du moins) que c’est Mitterrand, pourtant vilipendé depuis quelques années, qui, au retour de Maastricht, a inscrit, dans l’article 2 de la constitution le Français comme langue officielle du pays. C’est récent.
Et je cite : « Pourquoi a-t-il fait cela ? Et bien parce qu’il avait parfaitement compris que ces accords, qui ont donné à l’Europe sa configuration actuelle, étaient en train de consacrer quelque chose d’absolument redoutable qui est la loi du profit sous la forme néolibérale. Le vecteur de tout cela, c’est l’anglais ».
La charge contre ce qu’il appelle « l’idéologie néolibérale » a ravi mon petit cœur confit de craintes. Et sur la langue, et sur notre fonctionnement économique. Son postulat, c’est que cette normalisation galopante représente un grave danger pour notre espèce puisque, jusque-là, elle a évolué par différentiation. Il a appelé cette tendance, l’homogénéisation du langage, un cul de sac évolutif. Au cours des discussions, Claude Hagège montre la manière dont a disparu le gaulois, tout simplement parce que la langue du Romain s’est introduite dans l’intimité du foyer. Alors que nous étions « gaulois », notre parler originel n’a laissé qu’une centaine de mots.
Autre citation, que j’ai pour ma part trouvé délicieuse : «… le culte de la politique, capital ! Activité humaine essentielle. Il y a des imbéciles qui disent : je ne fais pas de politique. Qui n’en fait pas ! Je réponds à ces gens-là : abruti, c’est notre activité de tous les jours ».
Hagège évoque également l’OIF, l’Organisation internationale de la Francophonie, qui ne reste pas circonscrite à ce que des fâcheux pourraient assimiler à des relents de colonialisme, mais regroupe également des pays d’Europe centrale ou d’Asie du Sud-est qui n’ont jamais été mis à notre botte féodale. Il signale que la francophonie, par l’un des paradoxes de l’histoire contemporaine, est tout, sauf une affaire française.
Et ma pensée papillonne : est-ce pour cela que Madame Taubira, notre meilleure oratrice, dont la langue est une merveille d’intelligence et de finesse, subit cette dénégation de son humanité ? Parce que les allumés de l’insulte raciste manquent de vocabulaire et bavent d’envie ?
Quand Sarkozy jouait « massacre à la poinçonneuse »
 Vouloir faire « peuple », tout en se vautrant dans le luxe que permet la fortune, voilà qui n’a pas rebuté Sarkozy. Je me suis toujours demandé s’il parlait aussi mal, dans la vraie vie, ou si son relâchement verbal n’était qu’un artifice pour les ondes. J’ai relevé, durant le règne de ce lamentable président quelques phrases assez typiques de son style, quand il n’était pas accompagné par la plume de Guaino.
Vouloir faire « peuple », tout en se vautrant dans le luxe que permet la fortune, voilà qui n’a pas rebuté Sarkozy. Je me suis toujours demandé s’il parlait aussi mal, dans la vraie vie, ou si son relâchement verbal n’était qu’un artifice pour les ondes. J’ai relevé, durant le règne de ce lamentable président quelques phrases assez typiques de son style, quand il n’était pas accompagné par la plume de Guaino.
- « ils y ont le droit, ils y ont le droit »
- « Vincent Bolloré m'a dit : “ Viens passer trois jours sur mon bateau ”, et comme il est gentil et qu'il savait que ma famille battait de l'aile, il m'a dit : “ Peut-être que ça va arranger les choses. ” [...] Comme une partie de mon cerveau était consacrée à sauver autre chose, je n'ai pas impacté le poids du symbole. »
- « Je n'avais d'ailleurs pas l'intention de le toucher, son physique n'était pas tellement agréable que j'avais l'intention d'aller au contact »
- « Si y en a que ça les démange d'augmenter les impôts, [...]. »
- « On se demande c'est à quoi ça leur a servi toutes ces années pour avoir autant de mauvais sens ! »
Que vouliez-vous que cet inculte aille faire dans la galère d’un pays d’art, d’idées, de créativité ? Sinon le vendre à l’unique de la pensée néo-libérale.
Pour en terminer…
Si je veux raconter un souvenir ancien où je tenais un espace dédié aux métiers d’art, et que ça prenne cet aspect…
I’m petting un câble… Because I’m standing sur un stand in a big exposition. And the public is des personnes, pas des pipoles, qui are releving bien plus de “radio ale soccer” que de Château Of Versailles. Encore que… And I’m very tired, pas tirée, ni les traits, ni le reste. I’m chauffing sous le sun and I can pas aller drink a coup tranquillou. I’m alone sur mon stand. And I have très chaud. I’m debout on my feet all the day depuis plusieurs days.
It is the crisis. The persons pinaillent. Elles s’exclament : “Oh ! Il’s beautiful ! Zehr schön ! Mziane ! etc… !”. But the porte-monnaie are closed. Very closed. People are preferring buy dix merdes chez O’Champ plutôt qu’une nice chose in the exposition. For the same price. Problem de pédagogie ? de Society ? I don’t know. I think in my little tête : “Problem de publicity – Society de crazy consummation”.
Bon. Now, tout de suite, d’abord, I have taking five minutes to eat un bout. Et comme I’m alone, I’m ecouting my voisins. Pauvre word ! Poor monde !
- « Moi j’ai travaillé avec André Putmann…»
- « Moi, je connais Christian Lacroix… »
I’m going to penser : « Vas-y bonhomme ! Pérore ! Tu vas, peut-être, arriver à jumper in the bed with the dame… ». I’m rigoling. For me, French bonne femme inadaptée, je trouve the commun of mortels very strange. I’m dising to me, about the saumon qui is dragging the dame : “Et la gentillesse… la simplicité… As-tu try ?”. I know, ich bin incohérente. Mâ liche. And I don’t like the veau farci. But c’est the only menu possible.
Et alors ?
Franchement ? Peut-on imaginer qu’un jour il nous naisse un nouveau Camus, ou un nouveau Proust ? Avec un tel globiche ? Il faut sauver la langue française ! Parce que la pensée unique ET anglo-saxonne, est extrêmement pauvre. Sans, évidemment, nier les grands auteurs anglais qui doivent, les malheureux, faire les ventilateurs au fond de leur tombe. Où l’on tire la langue vers le bas pour tirer les bénéfices vers le haut…
Source de la vidéo : lekiosqueauxcanards.fr, le samedi 16 novembre 2013
Quand « anglais » rime avec « mauvais » !

Quand "English" rime avec "rubbish",
Quand « anglais » rime avec « mauvais » !
Les ressources substantielles, matérielles ou non, que les non-anglophones consacrent à l’anglais sont directement soustraites à la poursuite de leurs travaux de recherche théorique ou empirique, en laboratoire ou sur le terrain. On assiste ainsi à un très net ralentissement et même à un « détournement » de la recherche.
Les effets délétères de l’hégémonie de l’anglais sur la recherche
Il est bien connu que l’hégémonie de l’anglais en science exerce des effets négatifs à plusieurs niveaux. Au plan émotionnel, les chercheurs non anglophones contraints de publier en anglais font l’expérience de frustrations identitaires et de déchirements entre des valeurs contradictoires. Au plan culturel les autres langues sont en passe de subir de dramatiques « pertes de domaines », selon la terminologie des linguistes, puisqu’elles ne pourront plus exprimer des pans entiers de la science, lesquels auront été développés uniquement en anglais. Et sur le plan de l’ordre (ou désordre) politique international, l’hégémonie de l’anglais conforte le statut de producteur de science de certains pays tout en maintenant les autres dans celui de simples consommateurs.
Certains rétorqueront que ce sont là des considérations humanitaires et politiques qui peuvent intéresser Mère Teresa, Sigmund Freud, ou Fidel Castro, mais qui n’ont aucune place dans une réflexion sur ce qui est bon pour la science. Qu’importe que l’anglais hégémonique ait des impacts négatifs s’il bénéficie à la science et aux chercheurs !
La question qu’on doit se poser ici est donc : l’hégémonie de l’anglais favorise-t-elle la recherche? La réponse est loin d’être univoque puisqu’on peut identifier (au moins) cinq effets délétères qui y sont associés.
« La question qu’on doit se poser ici est donc : l’hégémonie de l’anglais favorise-t-elle la recherche ? La réponse est loin d’être univoque puisqu’on peut identifier (au moins) cinq effets délétères qui y sont associés ».
1. Ralentissement de la recherche
De nombreuses études montrent que la pression à rédiger communications, articles, et demandes de subventions, en anglais, crée une nette inégalité entre chercheurs anglophones et non anglophones. Elle oblige les non-anglophones à consacrer des ressources très importantes à l’apprentissage et à la correction de l’anglais, et à la traduction.
Lorsqu’il y a apprentissage de l’anglais par le chercheur, celui-ci doit investir de l’argent et du temps dans des cours d’anglais, démultiplier le temps passé à rédiger et, dans le cas des communications, à pratiquer, et mobiliser des réseaux personnels et/ou professionnels pour revoir et corriger son anglais. Lorsque le chercheur fait le « choix » de la traduction, il doit y consacrer des sommes très importantes, et investir un temps considérable pour trouver le bon traducteur, ce qui ne le dispense pas pour autant de pratiquer pendant des heures ses communications traduites par un tiers.
Cette nouvelle inégalité entre chercheurs est déplorable sur le plan humain et défavorise les carrières des non-anglophones. Mais l’essentiel est qu’elle nuit considérablement à la recherche entendue comme entreprise collective. Des gens formés pendant de longues années et recrutés pour produire des connaissances se retrouvent ainsi empêtrés dans des activités qui n’ont en soi rien de scientifique.
Ne nous faisons aucune illusion, le jeu ici est bel et bien à somme nulle. Les ressources substantielles, matérielles ou non, que les non-anglophones consacrent à l’anglais sont directement soustraites à la poursuite de leurs travaux de recherche théorique ou empirique, en laboratoire ou sur le terrain. On assiste ainsi à un très net ralentissement et même à un « détournement » de la recherche.
2. Indifférence à certaines contributions
La traduction, même quand elle s’avère possible, ne dispense pas les chercheurs non-anglophones d’utiliser l’anglais. Il n’est qu’à penser aux congrès internationaux en anglais, où ils ne peuvent évidemment pas se faire accompagner par un traducteur. Dans ces congrès, les communications prononcées dans un anglais approximatif parviennent au mieux à susciter une écoute polie et endormie, et débouchent rarement sur de réelles discussions. Certains commentateurs vont jusqu'à soutenir que les chercheurs non anglophones ne sont pas simplement devenus inégaux, mais qu’ils sont désormais « stigmatisés », au sens du sociologue américain Erving Goffman.
 Leur mauvais anglais est ainsi abusivement associé à des caractéristiques personnelles comme la paresse ou une intelligence moindre. Leurs manuscrits sont évalués d’abord en fonction de la qualité de leur anglais, le contenu scientifique étant plus ou moins laissé à l’arrière-plan. Cette situation est d’ailleurs reconnue par des éditeurs de grandes revues anglophones. On peut même se demander si le pays d’origine des manuscrits et les noms des chercheurs n’agissent pas comme filtres à la première étape du peer review.
Leur mauvais anglais est ainsi abusivement associé à des caractéristiques personnelles comme la paresse ou une intelligence moindre. Leurs manuscrits sont évalués d’abord en fonction de la qualité de leur anglais, le contenu scientifique étant plus ou moins laissé à l’arrière-plan. Cette situation est d’ailleurs reconnue par des éditeurs de grandes revues anglophones. On peut même se demander si le pays d’origine des manuscrits et les noms des chercheurs n’agissent pas comme filtres à la première étape du peer review.
Dans cette optique, il vaudrait mieux être Martin Smith de Leeds que Roberto Ruggieri de Milan (cet exemple utilise délibérément des noms masculins). La stigmatisation des non-anglophones semble trouver sa meilleure confirmation dans la réduction de leur employabilité. Des études montrent en effet qu’aussi bien en sciences sociales que naturelles, les employeurs privilégient l’embauche de chercheurs ayant fait leur doctorat ou postdoctorat dans des universités anglophones. Ici aussi, cette situation a des conséquences néfastes sur la recherche. Elle conduit à la priver d’apports de chercheurs non anglophones, dont certains pourraient s’avérer décisifs.
« Des études montrent qu’aussi bien en sciences sociales que naturelles, les employeurs privilégient l’embauche de chercheurs ayant fait leur doctorat ou postdoctorat dans des universités anglophones ».
3. Appauvrissement du raisonnement et des échanges
Maîtriser l’anglais au même titre que les locuteurs natifs ne va pas de soi. L’économiste des langues François Grin estime que pour comprendre, parler en public, débattre, et négocier, en anglais, il faut investir 12 000 heures d’étude et de pratique, ce qui correspond à 4 heures par semaine, 10 mois par an, pendant 75 ans. Dès lors, il n’est pas étonnant que les chercheurs non anglophones qui utilisent l’anglais le fassent avec difficulté.
Il s’avère que les non-anglophones ne disent pas ce qu’ils veulent, mais ce qu’ils peuvent. En France, ce sont 42 % des chercheurs qui sont concernés. D’autres études montrent que les non-anglophones ne comprennent pas tout ce qu’ils entendent en anglais. Mentionnons par exemple que des chercheurs et ingénieurs coréens saisissent moins de 50 % du contenu auquel ils sont exposés, lors même qu’ils résident au Royaume-Uni. Bref, les anglophones sont mal compris de leurs pairs non anglophones. Ces deux facteurs expliquent que dans les congrès internationaux, les échanges sont entièrement dominés par les anglophones, les non-anglophones ne pouvant pas véritablement participer.
Et pour ajouter l’insulte à l’injure, les occasions se multiplient où l’anglais est pratiqué en l’absence d’anglophones. Dans des pays comme le Japon, l’utilisation de l’anglais est en train de s’imposer même dans les activités qui ne regroupent que des natifs. Sans surprise, les chercheurs rapportent que les discussions sont moins animées en globish qu’en japonais. Il est donc très clair que la difficulté à maîtriser l’anglais à laquelle sont confrontés les non-anglophones a un fort impact négatif sur la recherche. C’est le raisonnement individuel et collectif, de même que la quantité et la qualité des échanges scientifiques, qui se trouvent ainsi sérieusement appauvris.
« Il s’avère que les non-anglophones ne disent pas ce qu’ils veulent, mais ce qu’ils peuvent ».
4. Réduction du pluralisme
Loin d’être un simple code de communication, une langue est indissociable d’une culture. Elle porte les traces des conditions sociales dans lesquelles elle s’actualise : valeurs, histoire, coutumes, œuvres, positionnements de ses locuteurs. Si les mathématiques sont l’outil privilégié des sciences « ingénieriques » et naturelles, celui des sciences humaines et sociales (SHS) est le langage. Il n’est qu’à comparer les articles scientifiques des unes et des autres pour s’en convaincre. L’adoption de l’anglais en SHS ne permet pas simplement une (supposée) plus grande diffusion des résultats. Elle conduit à adopter du même coup les traditions conceptuelles et théoriques, les objets d’étude, les postulats épistémologiques, et les choix méthodologiques associés à l’anglais et à ses locuteurs natifs.
Du point de vue épistémologique, la recherche anglophone, américaine en particulier, a tendance à considérer que les SHS doivent émuler les sciences naturelles. Cela a des répercussions sur tous les autres aspects. Sont ainsi privilégiées des théories qui voient dans l’ordre des choses un donné, par exemple le fonctionnalisme plutôt que le féminisme, de même que des méthodes quantitatives plutôt que qualitatives.
L’adoption de l’anglais conduit aussi à la marginalisation des objets locaux, y compris à l’extérieur des SHS, en sciences environnementales notamment, au profit d’objets théoriques ou d’objets « centraux », c'est-à-dire appartenant de fait aux sociétés anglophones. Pour se donner une idée de la réduction du pluralisme à laquelle nous pourrions un jour assister, mentionnons que l’Asie et l’Amérique latine, qui ont connu récemment une très forte croissance de leurs publications en sciences sociales, citent majoritairement (de l’ordre de 55 %) des revues scientifiques nord-américaines. Certains commentateurs prédisent ainsi que l’hégémonie de l’anglais pourrait déboucher sur une véritable « stérilisation » du processus créatif en SHS.
« Certains commentateurs prédisent ainsi que l’hégémonie de l’anglais pourrait déboucher sur une véritable "stérilisation" du processus créatif en sciences humaines et sociales ».
5. Effritement de la compétence
Pendant longtemps la plupart des chercheurs ont parlé ou lu une 2e et une 3e langue, et cela valait bien évidemment pour les chercheurs anglophones. Rappelons que la thèse du physicien américain Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique, est rédigée en allemand. L’admission aux programmes d’études supérieures requérait d’ailleurs des compétences en langues étrangères.
Aujourd’hui, la majorité des chercheurs anglophones ne peuvent lire qu’une seule langue, la leur, ce qui ne semble guère causer d’émoi au sein de la communauté scientifique. Pourtant, nous n’avons pas affaire ici à une simple perte d’habiletés culturelles, mais à une méconnaissance de la littérature scientifique. C’est bien d’effritement de la compétence scientifique qu’il s’agit. En effet, les chercheurs anglophones sont incapables de lire les travaux, répertoriés dans les grandes bases de données, qui ne sont pas rédigés en anglais. Ils sont tout aussi incapables d’accéder aux travaux, infiniment plus nombreux, qui ne figurent pas dans ces mêmes bases, connues pour indexer surtout les revues en anglais.
Certes, on entend souvent dire que les objets locaux sont étudiés dans la langue locale par tous les chercheurs, y compris par les anglophones. Selon cette logique, les spécialistes d’écosystèmes amazoniens liraient tous le portugais, les spécialistes de Mussolini liraient tous l’italien, etc.
Pourtant, l’expérience du Canada, pays officiellement bilingue, donne des signes que cette affirmation doit être relativisée. Les objets locaux canadiens engendrent une littérature dans chacune des deux langues officielles. Or, si les chercheurs canadiens francophones maîtrisent l’ensemble de cette littérature, des études indiquent que leurs pairs anglophones ignorent complètement les travaux en français. On ne peut pas exclure que le choix de l’ignorance soit motivé par des considérations purement politiques, mais il demeure que ce choix trouve une légitimation a posteriori dans l’idéologie de l’anglais-langue-de-la-science.
« Aujourd’hui, la majorité des chercheurs anglophones ne peuvent lire qu’une seule langue, la leur. Nous n’avons pas affaire ici à une simple perte d’habiletés culturelles, mais à une méconnaissance de la littérature scientifique ».
Conclusion
Il n’est guère risqué d’affirmer que combinés, les cinq effets délétères décrits ci-haut nuisent très sérieusement à la recherche. Le problème est bien réel, il est collectif, et à ce titre il appelle une réponse collective et mondiale.
Le monde scientifique donne régulièrement des signes d’en être conscient. On trouvait ainsi en 2012 cette affirmation sous la plume de deux éditeurs de Molecular Biology of the Cell, revue officielle de l’American Society of Cell Biology : "…advancing scientific progress, depends on elimination of obstacles faced by non-native speakers of the English language. This ideal can best be achieved when all members of the scientific community work together."
Quoi ? L’élite scientifique serait-elle plus éclairée que les élites politique et économique globalisées, dont l’aveuglement est en train de nous précipiter droit dans le mur ? On croit rêver! Malheureusement, le réveil est rapide. Le même éditorial affirme ensuite: "Non-native speakers of English must be aware that reviewers, editors, and journal staff do not have the time or resources to extensively edit manuscripts for language..."
Source : acfas.ca, avril 2015Popssibilité de réagir à cet article sur : http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/04/quand-english-rime-avec-rubbish
Publié par Ivan LE GALLO le 17 avril 2015
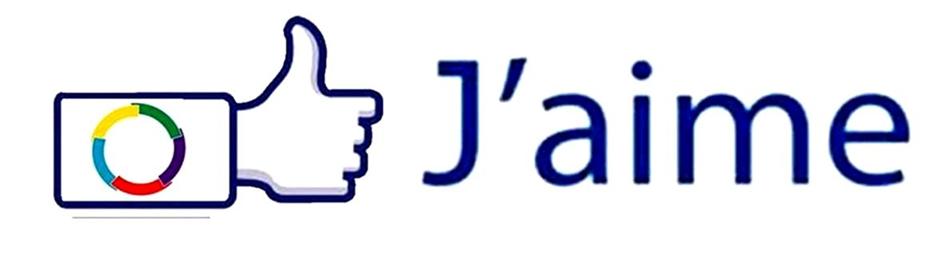 0 personne aime cet article.
0 personne aime cet article.
Aucun commentaire...





Identification
Veuillez entrer vos identifiants..
Créer un compte